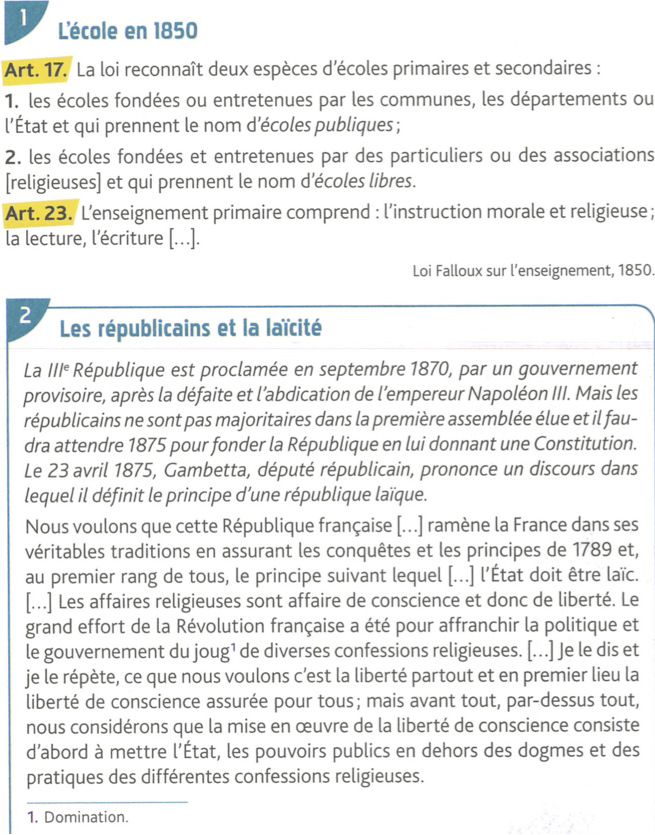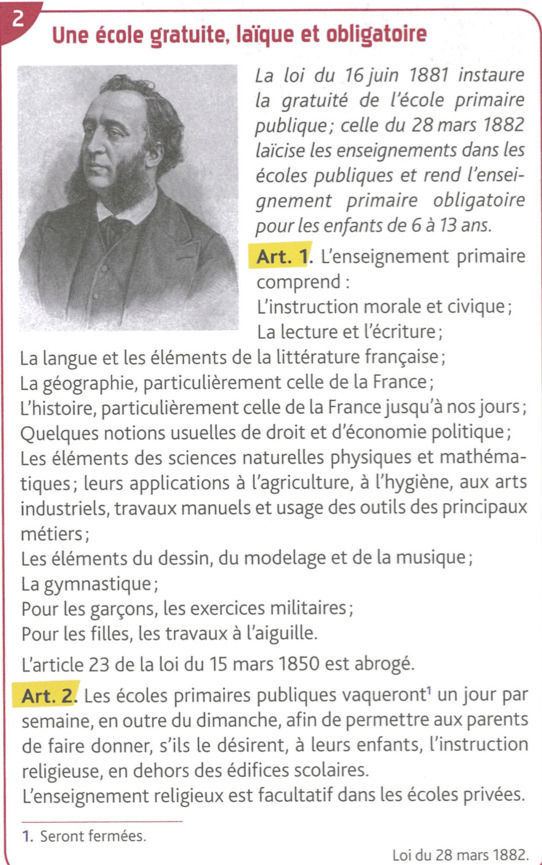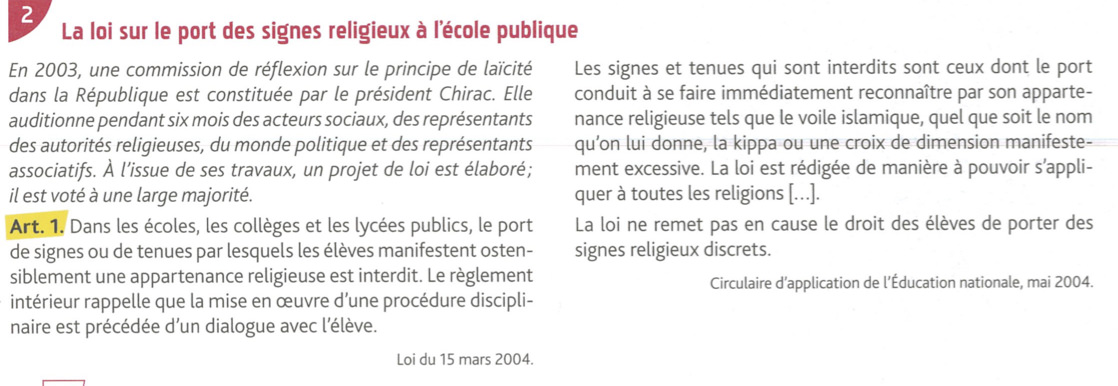la République et le fait religieux depuis 1880
De 1880 au début du xxe siècle, le temps deslois et des combats
Une série de lois sont mises en place à la fin du XXè siècle, sous la file République, pour laïciser les ins- titutions du pays et limiter l’influence de l’Église catholique. Dans les années 1880, l’~cote est au cur de la ques- tion laïque. Sous l’impulsion de Jules Ferry, en charge de l’instruction publique, trois grandes lois mettent en place une école primaire gratuite (1881), laïque et obligatoire (1882).
À l’enseignement religieux se substitue une éducation ci- vique et morale, assurée par des enseignants laïques. les lois scolaires de Jules Ferry réaffirment la liberté de conscience et reconnaissent l’existence d’une école privée. Cependant, elles sont mal reçues par l’Église catholique qui perd ainsi son droit de contrôle dans les écoles publiques. Elles marquent le début de la « guerre scolaire » (situation 1).
En 1904, c’est la rupture des relations diplomatiques entre La RépubLique et Le pape. Les deux camps s’opposent parfois violemment. La séparation des ÉgLises et de l’État est devenue iné- vitable. Engagée dans un esprit de combat, elle se conclut sous l’impulsion d’Aristide Briand, dans une volonté d’apai- sement" la loi de séparation de 1905 affirme la liberté de conscience et garantit te libre exercice des cuites. Les religions minoritaires acceptent le texte, alors que l’Église catholique oppose des résistances (situation 2), notam- ment à l’occasion des inventaires de biens des églises avant leur attribution à des associations cultuelles en 1906. Les relations diplomatiques avec la papauté ne sont rétablies qu’en 1924.
Au milieu du xxe siècle à nos jours, le temps de l’apaisement ?
La querelle scolaire se ravive autour de la question des aides publiques à l’école privée, en 1945, après la politique de Vichy, favorable à l’enseignement privé confessionnel. La loi Debré de 1959 (mal accueillie par les partisans de l’école laïque) institutionnalise l’aide de l’État aux établissements privés dans le cadre de contrats. On reconnaît aux établissements privés leur participation au service public d’enseignement. À ce titre, ils doivent appli.- quer les programmes de t’Éducation nationale et respec- ter la liberté de conscience tout en conservant leur « caractère propre ». En contrepartie, t’État prend à sa charge la rémunération des enseignants et une partie des frais de fonctionnement. Aujourd’hui, cette double composante de « l’école privée » et de « l’école publique » est inscrite dans le paysage scolaire français. Néanmoins, chaque fois que l’équilibre semble compromis, tensions et mobilisations resurgissent.
République laïque doit faire face à de nouveaux enjeux. La France est aujourd’hui un pays de pluraLisme re- ligieux. Aux religions reconnues par le Concordat du début du xtxe siècle (catholique, protestante, juive), s’ajoutent la religion musulmane (deuxième de France avec 5 millions de fidèles) et la religion bouddhiste (400 000 fidèles). Un des enjeux de ce pluralisme religieux est la construction de lieux de culte, dans le respect de la loi de 1905 (situa- tion 3). La lai’cité, inscrite dans La Constitution, apparaît comme garante des valeurs communes, pour rassembler, au-deLà des différences et des crispations identitaires, une population française riche de sa diversité. Ainsi, en 2004, l’État a légiféré sur le port des signes religieux ostentatoires à l’école pubLique. Ce principe de neutralité s’applique à tous les services publics.
De 1880 au début du xxe siècle, le temps deslois et des combats
Une série de lois sont mises en place à la fin du XXè siècle, sous la file République, pour laïciser les ins- titutions du pays et limiter l’influence de l’Église catholique. Dans les années 1880, l’~cote est au cur de la ques- tion laïque. Sous l’impulsion de Jules Ferry, en charge de l’instruction publique, trois grandes lois mettent en place une école primaire gratuite (1881), laïque et obligatoire (1882).
À l’enseignement religieux se substitue une éducation ci- vique et morale, assurée par des enseignants laïques. les lois scolaires de Jules Ferry réaffirment la liberté de conscience et reconnaissent l’existence d’une école privée. Cependant, elles sont mal reçues par l’Église catholique qui perd ainsi son droit de contrôle dans les écoles publiques. Elles marquent le début de la « guerre scolaire » (situation 1).
En 1904, c’est la rupture des relations diplomatiques entre La RépubLique et Le pape. Les deux camps s’opposent parfois violemment. La séparation des ÉgLises et de l’État est devenue iné- vitable. Engagée dans un esprit de combat, elle se conclut sous l’impulsion d’Aristide Briand, dans une volonté d’apai- sement" la loi de séparation de 1905 affirme la liberté de conscience et garantit te libre exercice des cuites. Les religions minoritaires acceptent le texte, alors que l’Église catholique oppose des résistances (situation 2), notam- ment à l’occasion des inventaires de biens des églises avant leur attribution à des associations cultuelles en 1906. Les relations diplomatiques avec la papauté ne sont rétablies qu’en 1924.
Au milieu du xxe siècle à nos jours, le temps de l’apaisement ?
La querelle scolaire se ravive autour de la question des aides publiques à l’école privée, en 1945, après la politique de Vichy, favorable à l’enseignement privé confessionnel. La loi Debré de 1959 (mal accueillie par les partisans de l’école laïque) institutionnalise l’aide de l’État aux établissements privés dans le cadre de contrats. On reconnaît aux établissements privés leur participation au service public d’enseignement. À ce titre, ils doivent appli.- quer les programmes de t’Éducation nationale et respec- ter la liberté de conscience tout en conservant leur « caractère propre ». En contrepartie, t’État prend à sa charge la rémunération des enseignants et une partie des frais de fonctionnement. Aujourd’hui, cette double composante de « l’école privée » et de « l’école publique » est inscrite dans le paysage scolaire français. Néanmoins, chaque fois que l’équilibre semble compromis, tensions et mobilisations resurgissent.
République laïque doit faire face à de nouveaux enjeux. La France est aujourd’hui un pays de pluraLisme re- ligieux. Aux religions reconnues par le Concordat du début du xtxe siècle (catholique, protestante, juive), s’ajoutent la religion musulmane (deuxième de France avec 5 millions de fidèles) et la religion bouddhiste (400 000 fidèles). Un des enjeux de ce pluralisme religieux est la construction de lieux de culte, dans le respect de la loi de 1905 (situa- tion 3). La lai’cité, inscrite dans La Constitution, apparaît comme garante des valeurs communes, pour rassembler, au-deLà des différences et des crispations identitaires, une population française riche de sa diversité. Ainsi, en 2004, l’État a légiféré sur le port des signes religieux ostentatoires à l’école pubLique. Ce principe de neutralité s’applique à tous les services publics.